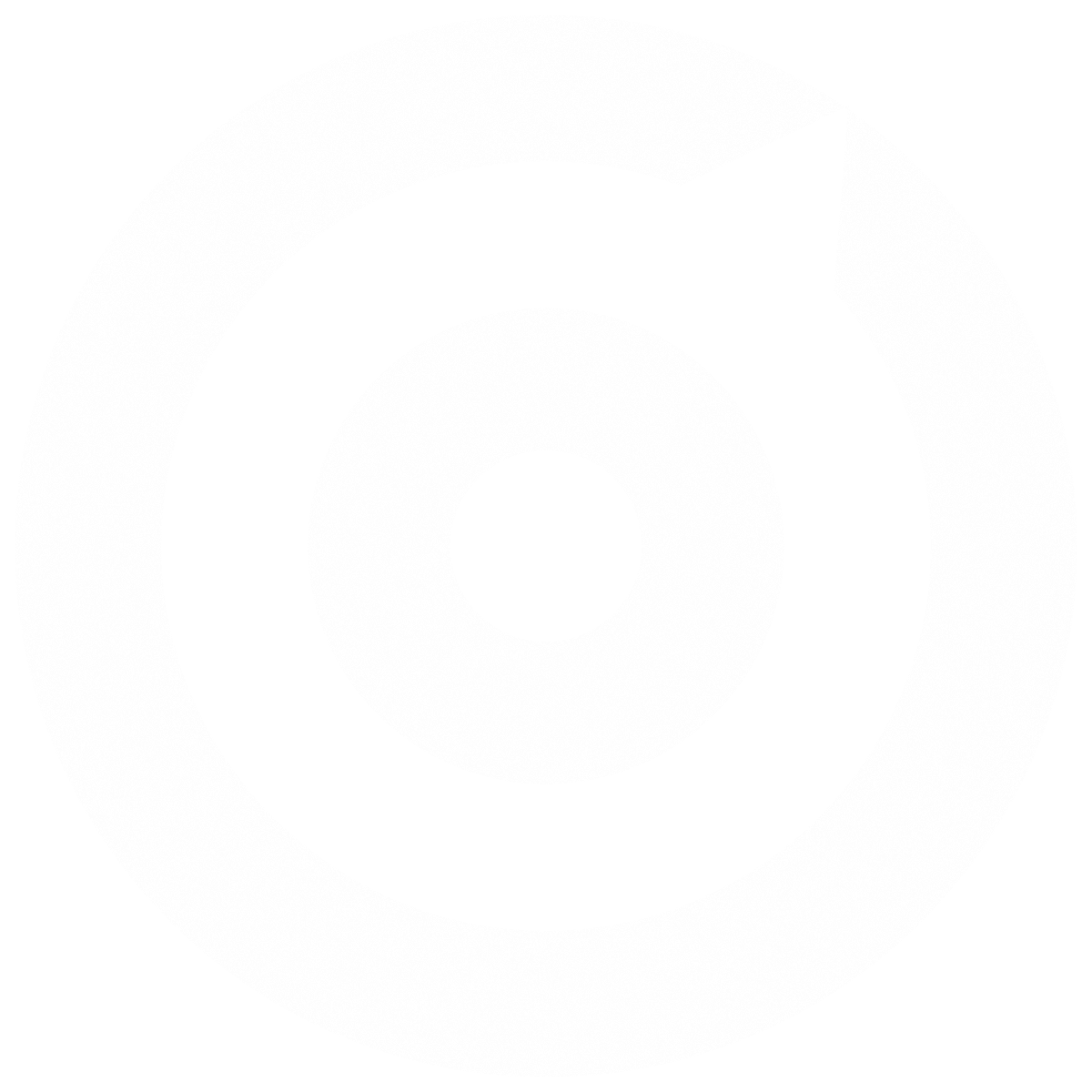Pendant très longtemps, les ressources naturelles n’ont pas été prises en compte dans l’économie, car à l’époque, elles ne représentaient pas un facteur limitant. Elles sont donc absentes dans l’équation économique classique « production = capital + travail ». Néanmoins, ces ressources ainsi que la capacité d’absorption globale des déchets, deviennent désormais limitantes, c’est pourquoi on parle de limites planétaires. Refuser de les intégrer dans l’équation économique conduit à obtenir systématiquement un résultat faux.
Changement de méthode de calcul
L’UE souhaite donc réorienter les capitaux vers des modèles d’affaires durables, améliorer la gestion des risques financiers entrainés non seulement par le bouleversement climatique, mais aussi par l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problèmes sociaux, et enfin de favoriser la transparence des activités économiques. Dans ce cadre, il est indispensable que les entreprises mettent les informations pertinentes à disposition mais aussi que ces informations soient standardisées afin de permettre un langage commun et des comparaisons.
À noter : les enjeux RSE sont désormais largement pris en compte dans les processus de financement des entreprises. Des capitaux sont réservés à des entités en mesure de prouver leur engagement sur ces terrains. Dans le cadre des fusions et acquisitions, les enjeux environnementaux et sociaux sont scrutés. Personne ne veut investir dans des entités non durables afin d’éviter les actifs échoués. L’information RSE est donc un véritable outil de financement, une clé de discrimination permettant aux investisseurs de séparer le grain de l’ivraie.
C’est dans ce contexte évolutif que la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive),qui désigne la directive 2022/2464 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022, complétée par le règlement délégué 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023, a été adoptée. Elle remplace la NFRD (directive du 22/10/2014) qui imposait la publication d’une déclaration de performance extra-financière (DPEF) à certaines entreprises.La DPEF devient ainsi officiellement « état de durabilité » (pour faire écho aux états financiers) on parle plutôt de rapport de durabilité. Ce dernier doit être établi sur le même périmètre que les états financiers, et cette fois sur des sujets préétablis (sociaux, environnementaux et gouvernance) et en respectant des normes précises de publication. Le cœur de la directive est la « double matérialité », à savoir l’analyse des impacts de l’entreprise sur certains paramètres (par ex. pollution, ressources hydriques, biodiversité et écosystèmes) mais aussi celle de son niveau de dépendance financière à ces mêmes paramètres. À noter que l’assiette des entreprises concernées est également plus large pour la CSRD que pour la NFRD.
L’objectif à terme est double : informer en bonne et due forme les investisseurs et inciter les décideurs à réfléchir sur la pérennité de leurs modèles d’affaires au vu des nouvelles réalités terrestres pour les modifier et passer sur une trajectoire durable. Les entreprises qui existeront encore demain seront celles qui auront fait cet exercice d’introspection.
Remettre en question son modèle d’affaires, c’est grave ?
Aujourd’hui, il paraitrait totalement irresponsable de refuser d’envisager le changement des pneus d’une voiture. La réflexion sur le modèle d’affaires est du même ordre. Elle est indispensable à la pérennité de l’entreprise. Le monde évolue, les opportunités changent, les marchés et les clients aussi. La durée de vie moyenne d’un pneu est de 50 000 km, celle d’un modèle d’affaire est de 10 ans. Cette réalité doit être intégrée dans la gestion de l’entreprise, même si elle est difficile à accepter. Une réflexion aboutie avec de nouvelles pistes, des scénarios et une feuille de route, tel est le GPS du/de la dirigeant-e. C’est exactement ce que propose la CSRD : se poser les bonnes questions avec les bonnes métriques pour rester sur un chemin carrossable et éviter de s’embourber dans le marigot.
On a combien de temps ?
Le calendrier de mise en application de la directive est le suivant :
| Année de reporting | Entreprises concernées |
| 2025 (sur l’exercice 2024) | Entreprises remplissant deux des critères suivants : > 500 salariés, > 50 millions € de CA, > 25 millions € de total de bilan |
| 2026 (sur l’exercice 2025) | Entreprises remplissant deux des critères suivants : > 250 salariés, > 50 millions € de CA, > 25 millions € de total de bilan |
| 2027 (sur l’exercice 2026) | PME cotées en bourse (sauf entités avec < 10 salariés, un total du bilan ≤ 450 000 € ou un CA net ≤ 900 000 €) |
| 2029 (sur l’exercice 2028) | Grandes entreprises non européennes avec un CA européen > 150 millions € et une filiale/succursale basée en France avec un CA > 40 millions €. |
La rédaction du rapport implique un sérieux travail en amont : organisation de la procédure, des organes de pilotage et de contrôle, identification des normes pertinentes, analyse du niveau de pertinence de la dépendance financière et des impacts pour chacune d’entre elles, identification et mesure des risques et des opportunités, développement de la politique de gestion devant être mise en place. Il ne faut surtout pas sous-estimer les compétences, le volume de travail et le temps nécessaires à la préparation.
On rentre dans le dur
Jusqu’ici, les rapports de RSE étaient libres. Cette caractéristique n’enlève rien à leur valeur, ils ont représenté une étape fondamentale vers les bonnes pratiques. Désormais, un audit du rapport de durabilité par un auditeur (commissaire aux comptes ou organisme tiers indépendant) dûment accrédité par la Haute Autorité de l’Audit (H2A) via une formation de 90 heures est obligatoire. Au sein de l’entreprise, la procédure de nomination de cet auditeur, qui rendra un avis de conformité (conforme sans réserve, conforme avec réserve, non conforme), est identique à celle du commissaire aux comptes. Cette obligation vise à garantir le même niveau de fiabilité pour les informations de durabilité que pour les informations financières.
Cet état de durabilité est considéré comme une pièce indispensable au reporting. Il contient tous les éléments permettant aux parties prenantes de connaitre les tenants et aboutissants de l’entreprise et à la direction de savoir où elle se dirige. Au final, il ne s’agit plus d’une mise en conformité, mais bien de l’élaboration d’une carte, destinée à être utilisée pour avancer en slalomant entre les récifs, appelés à se multiplier en ces temps agités.