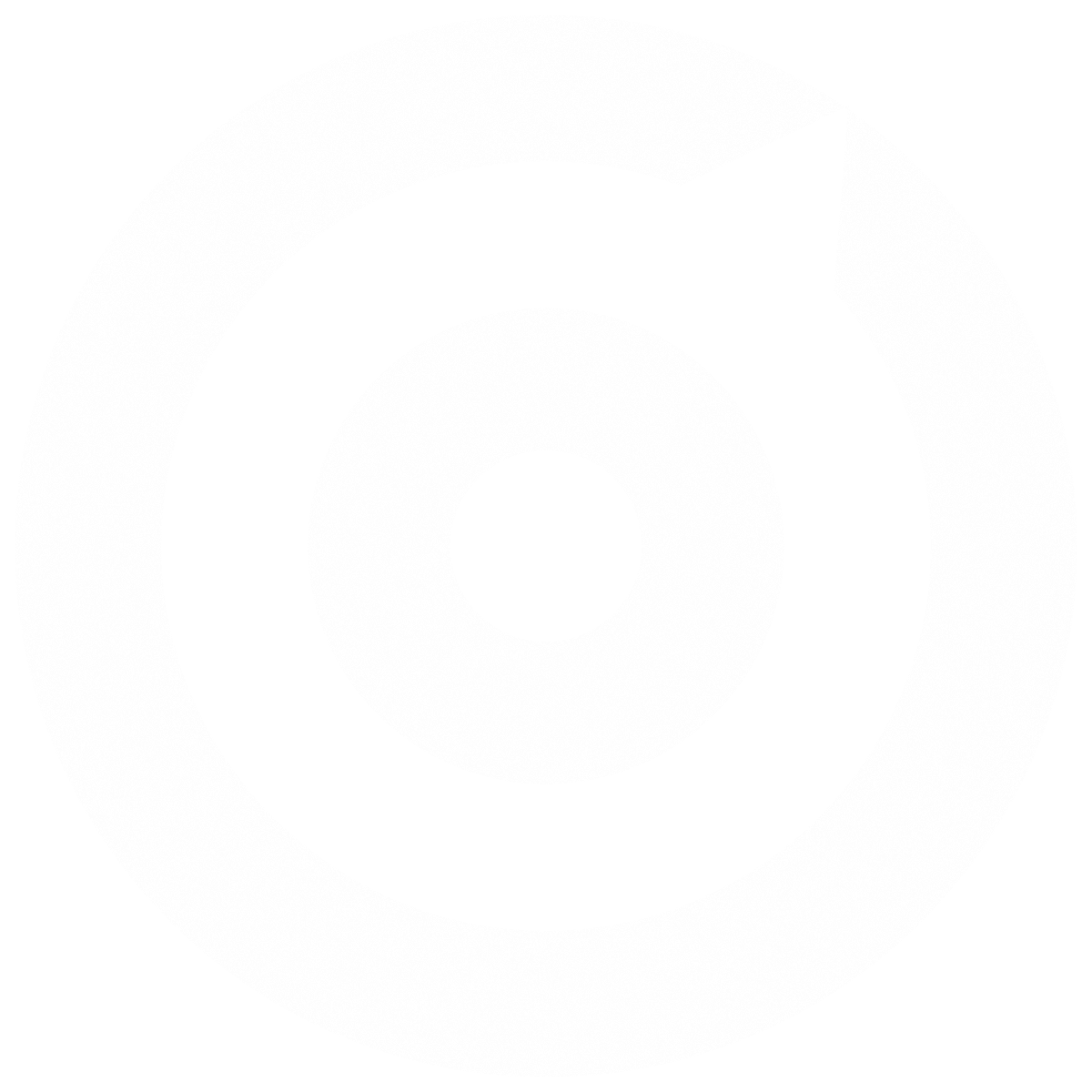Une question que nous avons souvent :
« Lors de l’analyse de double matérialité de l’ESRS E4, comment hiérarchiser les impacts de mon entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes ? » Notre approche repose sur l’examen des facteurs d’érosion de la biodiversité.
Le premier facteur d’érosion est la consommation d’espace, également appelée « changement d’usage des terres et des mers » (1) : sur la terre ferme, elle correspond à l’occupation de surfaces par l’être humain, par exemple l’extension de l’urbanisation ou les surfaces agricoles. Son préambule étant la destruction partielle ou complète des milieux naturels, cette occupation nuit particulièrement à la biosphère. Il convient donc d’intégrer ce facteur dans l’analyse de matérialité inhérente à la rédaction du rapport de durabilité.
Oui, mais comment ?
Toute activité économique entraîne une consommation d’espace : chaque entreprise occupe une certaine surface au sol. Néanmoins, l’esprit de la CSRD implique une hiérarchisation des impacts, il va donc falloir discriminer les entreprises « consommatrices d’espace » des autres.
- Mais où placer le curseur ?
- À partir de quelle surface doit-on considérer cette consommation d’espace comme pertinente en termes d’impact ?
L’analyse des sites naturels considérés comme revêtant une « valeur écologique » apporte une réponse : il apparait que la majorité des surfaces classées ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont supérieures à 1 ha (10 000 m2).
Autrement dit, pour qu’un écosystème puisse fonctionner de manière pérenne sur le plan écologique, une surface d’au moins 1 ha est nécessaire. Il apparaît donc pertinent de fixer le curseur à ce niveau :
=> toute entreprise utilisant un site occupant une surface supérieure ou égale à 1 ha sera considérée comme impactante sur la biodiversité et l’ESRS E4 sera donc vue comme matérielle.
Bien entendu, comme tout seuil discriminant, celui-ci est critiquable. Sur le plan purement scientifique, il serait ainsi possible d’argumenter que de plus petites surfaces pourraient aussi être écologiquement pérennes, comme une mare, par exemple. Néanmoins, nous évoluons ici dans un domaine qui sort du périmètre purement scientifique puisqu’il s’agit d’un cadre de politique publique qui a été érigé dans un esprit particulier : celui de la hiérarchisation de la pertinence des impacts. Le curseur doit donc être utilisable dans cette optique de hiérarchisation.
« Mais si nous considérons E4 comme matérielle, quelles conséquences ? »
Considérer une norme comme matérielle entraîne bien entendu des conséquences en termes de charge de travail pour le rapport de durabilité ainsi que des coûts pour sa gestion. Néanmoins, il convient de considérer trois points essentiels :
- Le rapport de durabilité est un exercice de transparence (pas que, mais aussi). Si une norme est matérielle, elle doit être considérée comme telle.
- Le rapport de durabilité est un outil d’information vis à vis des banques. Si une entreprise X « omet » de considérer l’E4 comme matérielle alors qu’elle l’est, et que le concurrent Y la prend en compte, X va devoir s’en expliquer (entre autres devant l’auditeur du rapport). En outre, Y pourrait rafler un financement éventuel sous le nez de X, mieux placé qu’il sera en termes de reporting ESG.
- Les mesures de gestion de l’impact sur la biosphère sont plutôt simples et peu coûteuses à mettre en place. Le vivant « veut » se développer, il suffit de lui en donner la possibilité.
En conclusion, nos éléments de réponse :
1- Considérer 1 ha comme la surface de discrimination entre les entreprises consommatrices d’espaces et les autres permet de faciliter l’analyse de la matérialité d’E4.
Bien entendu, l’examen d’autres aspects est nécessaire pour mener à bien cette analyse, mais ce discriminant permet de prendre en compte de manière simple la première cause d’érosion de la biodiversité pour tout type d’entreprise, où qu’elle se trouve et quel que soit son secteur d’activité.
2- Se faire accompagner sur l’évaluation de sa matérialité pour E4 permet également une analyse de de la chaîne de valeur. Par exemple, si votre entreprise fabrique ou revend des vêtements, la norme E4 est matérielle en raison de la dépendance de l’entité à la biodiversité (le coton et le lin font partie des matières premières) et des impacts sur cette dernière (occupation d´espace et pollution lors de la culture).
Pour recevoir plus d’informations sur notre proposition d’accompagnement : fvillatte@expertise-2772.eu.
Références :
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/listeZnieffhgjerhgmohemioh
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr